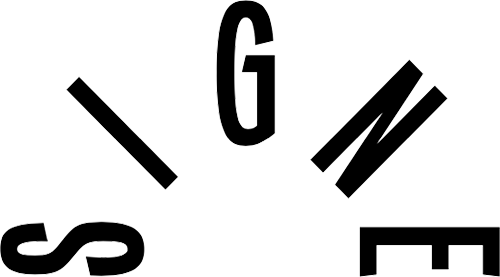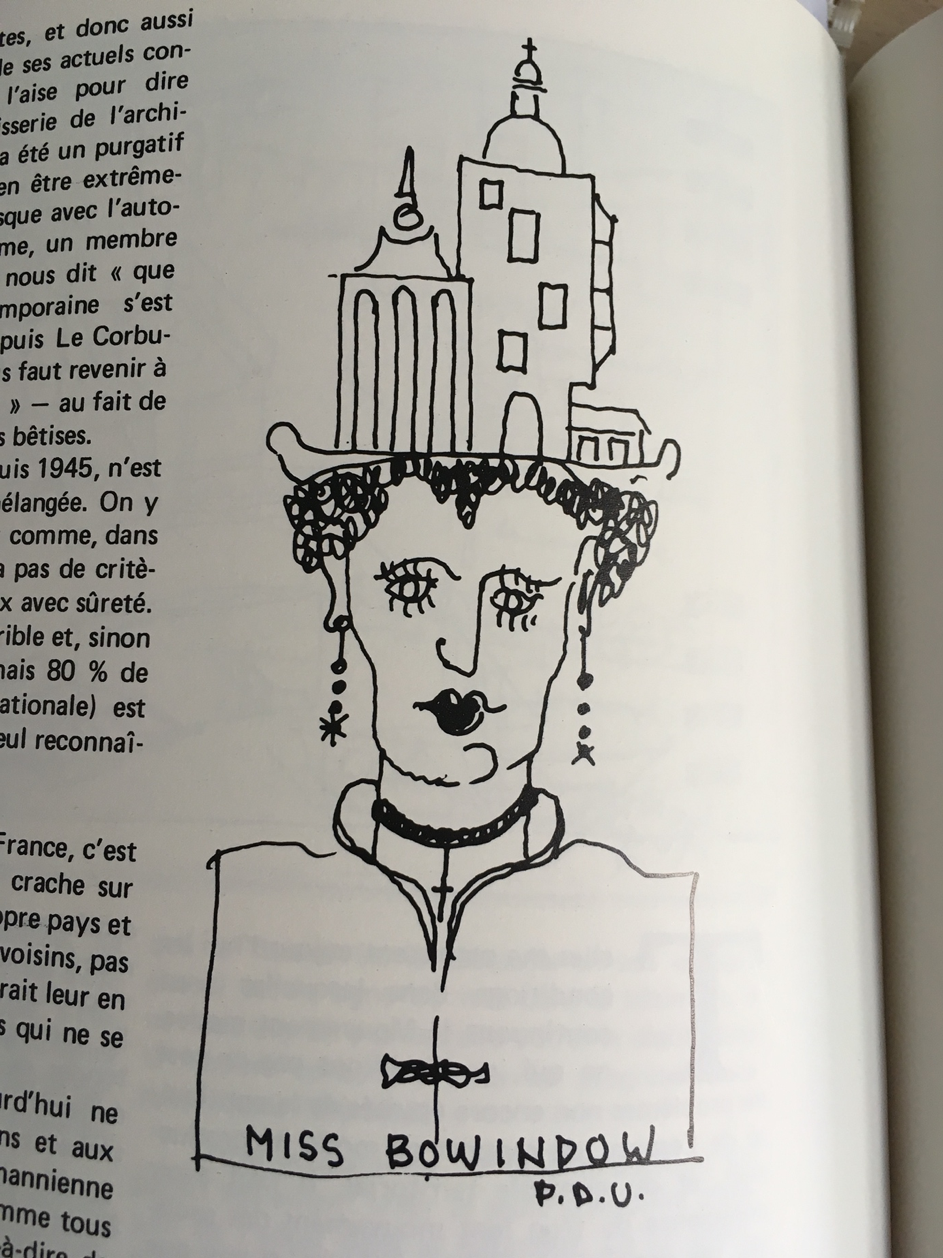
Caricature Miss Bowindow, dessin de Pierre Dufau, 1980
Les Cahiers de la recherche architecturale, n°6-7 « Architecture 1980 – Doctrines & incertitudes », Cera-Ensba, Paris, 1980, p.100
Les Cahiers de la recherche architecturale, n°6-7 « Architecture 1980 – Doctrines & incertitudes », Cera-Ensba, Paris, 1980, p.100
Nous imposant évitement et confinement, le pouvoir (médical et politique, bio-pouvoir comme il a été amplement rappelé) nous aura curieusement conduits à vivre-ensemble peut-être plus intensément que nous ne l’aurons jamais fait. C’est le propre de toute crise que de chercher à toujours instaurer sa raison supérieure. Une crise comme celle que nous traversons renferme toujours une signification et des effets qui dépassent ses seuls contenus sanitaires et économiques immédiats. Mais il faut éviter à tout prix qu’elle instaure sans contre-feux sa seule raison supérieure, nous l’avons trop vu ces jours derniers.
Comment imaginer le monde « d’après » - quoi qu’en ait Michel Houellebecq. D’abord en s’attachant au rythme, contre ce rythme imposé par la crise. Les rythmes sont sources de pouvoir et ont une fonction politique. Comment, dans le logement, préserver dès lors l’idiorythmie (Roland Barthes) de chacun : vivre ensemble, mais chacun à son propre rythme, ensemble mais séparés, toujours un peu. La passion du commun nous anime tous – mais à différentes heures de la journée !
Ensuite, et très concrètement, spatialement parlant, une terrasse, évidemment, enfin un balcon au moins ! Les architectures aujourd’hui trop souvent méprisées car issues de ce que l’on a dénommé le post-modernisme apportent en ce sens bien des leçons : les prolongements y sont nombreux, jardinés souvent, les balcons y sont légion, et surtout les terrasses y sont fréquentes, très fréquentes au regard de la production contemporaine, 35 à 40 ans plus tard, comme si une qualité d’usage s’était perdue au fil des années sous le joug de la rentabilité financière.
En ville dense, plus qu’une simple excroissance spatiale du logement, la terrasse devrait être considérée comme la partie la plus intime de l’espace public. Pourquoi ne pas déduire une partie de son coût de celui du seul logement (et de sa surface habitable) pour le reporter sur les coûts endossés par la collectivité dans la fabrique des espaces publics collectifs – d’une manière ou d’une autre, « bonus » foncier, report de charges… C’est en effet plutôt une contrainte de bilans comptables qui voit les promoteurs se refuser à financer ces prolongements extérieurs qui pourtant, et chaque acteur le sait bien, sont des arguments de vente sans équivalent.
Quant aux bow-windows, ils ont montré toute la pertinence d’ouvrir l’intérieur pour un peu de lumière supplémentaire quand bien même perturberaient-ils le dessin bien réglé d’une façade. Enfin, s’il est utile de le rappeler, le mur-rideau n’autorise pas le balcon. Il est en revanche évident que nous allons assister à un retour en force de l’hygiénisme en architecture – contre lequel s’était justement élevé et construit le post-modernisme.
Ces terrasses, ces bow-windows et ces balcons, on les trouve à Paris, côté logement social, dans les opérations oubliées de Michel Duplay, rue de la Py, rue d’Aubervilliers, ou plus tardivement quai de Jemmapes. Chez Yves Jenkins rue Eugène Carrière, chez AUSIA, rue Sthrau, chez Martin Van Treeck dans sa spectaculaire « révision », en face de ses Orgues de Flandre au 142 avenue de Flandre, chez Jacques Kalisz rue de Fontarabie… Pendant que les volontés encamaradées du « renaudisme » construisaient un peu partout une banlieue rouge et alternative.
Côté privé, on trouve ces prolongements multiples dans les quartiers chics chez Dominique Hertenberger et Jacques Vitry, chez Jean-Jacques Fernier (décédé en mars) et André Biro, sans oublier le trio Anger-Heymann-Puccinelli ces marginaux de l’intérieur qui avaient fait des prolongements de leurs logements le principe cinétique de leur écriture architecturale. Andrault (lui aussi décédé des suites du covid) et Parat ont su multiplier leurs « maisons-gradins-jardins » en Ile-de-France pour y offrir les qualités de l’individuel (la terrasse-jardin et la double entrée) tout en maintenant une densité comparable à celle des immeubles collectifs. La mobilité des occupants y a été faible et la satisfaction plutôt élevée, la plupart de ces opérations livrées en accession sociale à la propriété étant aujourd’hui devenues des résidences privées. Et puis n’oublions pas les « inconnus » qui ont énormément construit dans Paris et ses environs, Michel Reboul et A2r et leurs immeubles d’angle des rues Clovis, Brochant, Saint-Jacques, de Charonne… Et Raymond Ichbiah qui s’offrit le luxe d’une demi-rue (Vaugelas) dans le XVe et même un cœur d’îlot entier dans le VIIe, Ichbiah, l’un des architectes favoris de la Cogedim – bien avant Altarea, donc. En ce temps-là, Nexity n’était pas encore né, Kaufman livrait surtout des maisons, et la promotion privée, France Construction, la Franco Suisse ou Les Nouveaux Constructeurs, était (encore) un peu méprisée…
Cette architecture post-moderne était elle aussi issue d’une « crise », économique après 1973, mais un peu avant déjà d’une profonde et durable crise du consentement après les premières déceptions nées de la rencontre des masses avec le décor que leur proposaient les « grands ensembles ». Un sociologue a été parmi les premiers à l’identifier cette crise, signant avec Madeleine Lemaire en 1970 un article au titre qui fit date et résume à sa façon notre situation : « Proximité spatiale et distance sociale ». Le pouvoir s’est même un peu mélangé les crayons en cherchant à le plagier – naïvement sans doute – pour imposer son slogan de « distanciation sociale ». Le sociologue Jean-Claude Chamboredon nous a quittés au cœur de l’épidémie, le 31 mars, à l’âge de 81 ans.
Jean-Louis Violeau, Mai 2020