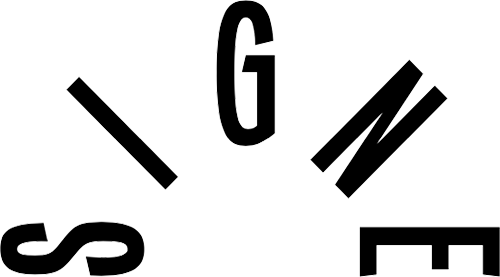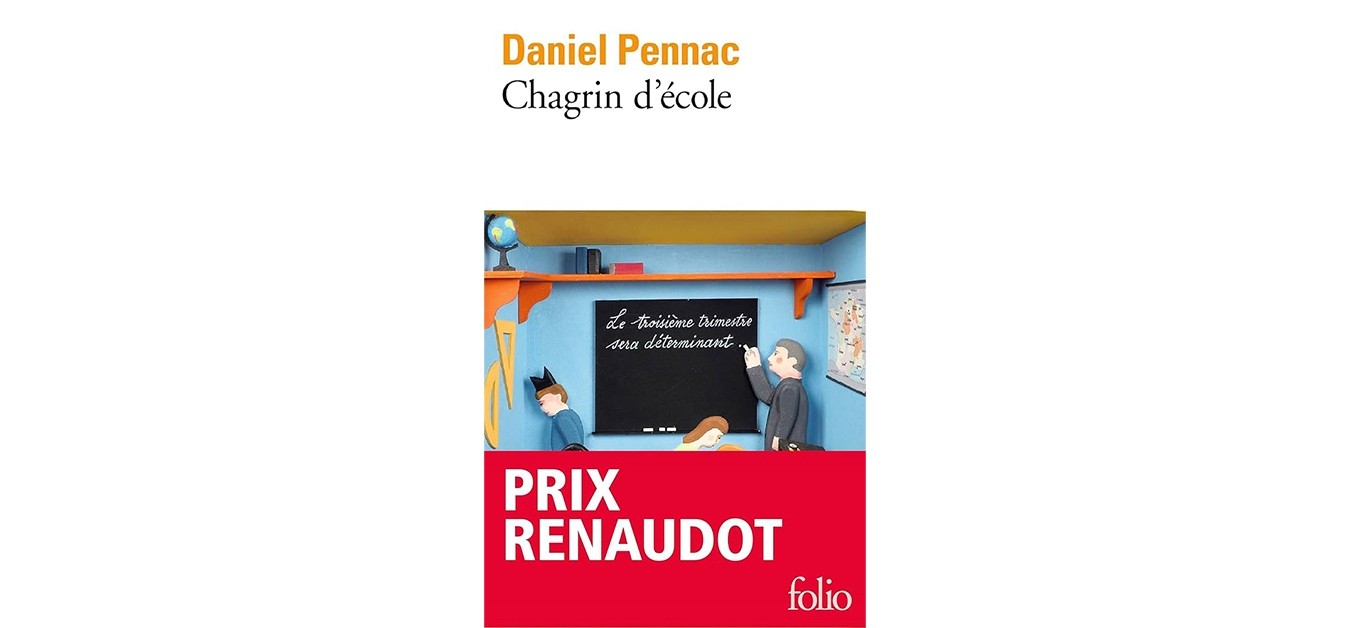À l’occasion de l'exposition "L'école idéale" et du livre qui lui est consacré, le Pavillon de l'Arsenal donne la parole au journaliste et critique littéraire Léonard Desbrières pour mettre ce thème en perspective, entre pop culture, littérature, art et architecture.
" C’est ce qu’on appelle le paradoxe français. Au pays des Lumières, héritier d’une tradition philosophique et littéraire, où l’éducation est au centre des réflexions depuis Montaigne et Rabelais en passant par Rousseau et Condorcet jusqu’à Bourdieu et l’historienne Mona Ozouf, on est obnubilé par l’École en tant qu’institution, en tant que lieu de formation de la jeunesse, de transmission des valeurs, de reproduction des élites. Une obsession idéologique sur laquelle débatent encore aujourd’hui, pédagogues et politiques, bien conscients de l’urgence à refonder l’École. Au point d’avoir glissé sous le tapis la première acception du terme, puisque c’est d’abord à un lieu que l’école réfère. Un bâtiment dont on ne dira jamais assez l’importance puisqu’il est le temple de l’enfance et donc la capitale du souvenir. Convoquer l’école, c’est faire surgir dans l’esprit de chacun d’entre nous des images. De nos camarades, nos professeurs mais aussi de nos salles de classes, les rangées dans les couloirs étroits, le préau où l’on s’abritait de la pluie, cette cour de récréation comme une bouffée d’air frais même si c’est le béton qui dominait.