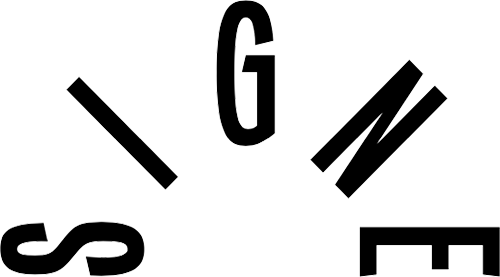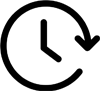Pendant mon enquête au Mirail, un habitant de longue date du quartier m’explique :
“Au moment de la démolition, je me rappelle qu’il y avait un copain à mes côtés. Et des gens passent, on s’arrête, on regarde, et ils disent : « Moi, mon père, il a travaillé là. Il a fait le chantier. Ça me fait quelque chose ». On passe. Une autre personne dit : « J’y ai habité tant d’années. ». Comme ça, les gens devant la démolition parlaient de ce qu’ils ressentaient à ce moment-là. On voyait qu’il y avait une épaisseur, qu’il y avait un rapport, qu’il y avait de la vie. Les gens parlaient de leur vie. Ce n’était pas simplement le béton. Il y avait une présence humaine. Ça disparaît. Il n’y a plus de traces.”Dans la suite de mon enquête, à Bagnolet, dans le quartier des Malassis, dans une tour sur le point d’être démolie, une histoire similaire se joue : une habitante me raconte qu’après 9 ans de vie dans la tour, son relogement a été fait contre-cœur, perdant le lien avec ses voisins et toutes ses habitudes. La démolition déchire le lien entre l’individu et son environnement familier, et ce à tous les âges. Une membre de l’association de quartier à La Reynerie qui s'occupe notamment de soutien scolaire, me raconte :
“
(...) Mais j'ai même des enfants qui vont m'en parler. Parce que par exemple j'ai une ado qui m'a dit “Mais en fait c'est en train de détruire tout mon quartier. C'est le quartier où j'ai grandi”. Elle habite à Satié. Donc ils ne sont pas encore touchés. Mais c'est vrai que ça la touche beaucoup. De voir tout ce paysage qu'on a depuis tout petit, qui change complètement.”
Rob Nixon, dans son ouvrage
Slow Violence and the Environmentalism of the Poor amène la notion de “slow violence” : une violence qui n’explose pas, qui ne fait pas spectacle, mais qui use et heurte à bas bruit. C’est exactement ce que produit la démolition a toutes ses étapes, en effaçant les supports matériels de la mémoire, les lieux où s’accrochent les histoires.
La logique de production urbaine, comme elle l’a toujours fait, privilégie une vision
macro, la valeur immobilière et, dans le cas des quartiers populaires, crée les conditions d'un risque de gentrification. Le récit intime des habitants, leur vie quotidienne est jugée non essentielle, voire interchangeable, par les planificateurs. Et parce que la transformation vise souvent une forme de
tabula rasa pour gommer le passé, elle finit également par effacer ce qui faisait la singularité sociale du lieu : ses luttes, ses solidarités, ses attachements, et même ses contradictions. En perdant prise sur leur quartier, les habitants sont relégués au rôle de spectateurs de leur propre histoire, victimes de "placelessness"
[5], perte du lieu.