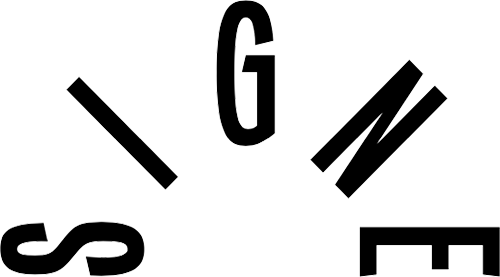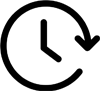1. Jacques Lacan, « L’objet de la psychanalyse » (1965-1966), séance du 5 janvier 1966, en ligne (https://ecole-lacanienne.net/wp-content/uploads/2016/04/1966.01.05.pdf).
2. René Kaës (dir.), Crise, rupture et dépassement, avec des textes d’A. Missenard, R. Kaspi, D. Anzieu, J. Guillaumin, J. Bleger, E. Jacques, Paris, Dunod, coll. « Inconscient et culture », 1979.
3. Voir Ludwig Binswanger, Le Problème de l’espace en psychopathologie, trad. C. Gros-Azorin, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1998, chap. 2 : « L’espace thymique ».
4. Voir Didier Anzieu, Le Penser. Du Moi-peau au Moi-pensant, Paris, Dunod, 1993 ; et D. Anzieu, Le Moi-peau, Paris, Dunod, 1985.
5. Voir Didier Houzel, « Enveloppe familiale et fonction contenante », in D. Anzieu (dir.), Émergences et troubles de la pensée, Paris, Dunod, 1994, p. 27-40.
6. Ibid., p. 31.
7. Voir Frédéric Worms, Le Moment du soin. À quoi tenons-nous ?, Paris, PUF, coll. « Éthique et philosophie morale », 2010.
8. Kenneth Frampton, « Towards a Critical Regionalism. Six Points for an Architecture of Resistance », in Hal Foster (éd.), The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture, Port Townsend (Washington), Bay Press, 1983.
9. Henri Lefebvre, La Production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974.
10. David Harvey, Spaces of Capital. Towards a Critical Geography, Londres, Routledge, 2001.
11. Voir ibid. ; et D. Harvey, Géographie de la domination, Paris, Les Prairies ordinaires, 2008.
12. Edmund Husserl, L’Arche-originaire Terre ne se meut pas, 1934, in E. Husserl, La Terre ne se meut pas, Paris, Éditions de Minuit, 1989.
13. Alexander Mitscherlich, Psychanalyse et urbanisme. Réponse aux planificateurs, Paris, Gallimard, 1965.
14. Paul Virilio et Claude Parent, « La fonction oblique, 1965-1967 », en ligne (www.frac-centre.fr/collection-art-architecture/architecture-principe/la-fonction-oblique-64.html?authID=10&ensembleID=30).
15. K. Frampton, « On Reading Heidegger », in Oppositions, no 4, MIT Press, 1974.
16. Voir Ivan Illich, H2O. Les eaux de l’oubli [1988], trad. M. Sissung, Saint-Mandé, éditions Terre Urbaine, coll. « L’Esprit des Villes », 2020.
17. Voir notamment Paul Eluard, Souvenirs de la maison des fous, Paris, Gallimard, 1945.
18. Tristan Tzara, « D’un certain automatisme du goût », Le Minotaure, no 3-4, 1933.
19. Gaston Bachelard, La Terre et les rêveries du repos [1948], Paris, José Corti, coll. « Les Massicotés », 2010 (2e édition).
20. Nicole Loraux, Les Enfants d’Athéna. Idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes [1981], Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 2007.
21. Comme l’est la « good-enough mother » chez Donald Winnicott (« The Good-Enough Mother », 1953).
22. G. Bachelard, La Terre et les rêveries du repos, op. cit.
23. Voir Paul Ricœur, « Autonomie et vulnérabilité », in Anne-Marie Dillens (dir.), La Philosophie dans la cité, Bruxelles, Presses de l’Université Saint-Louis, 1997.
24. Les termes, de Goldberg, sont rapportés par Michel Ragon, Goldberg. Dans la ville/On the City, Paris, Paris Art Center, 1985.
25. Jean-Pierre Vernant, « Hestia-Hermès. Sur l’expression religieuse de l’espace et du mouvement chez les Grecs », L’Homme. Revue française d’anthropologie, t. 3, no 3, septembre-décembre 1963.
26. Hermann Broch, Théorie de la folie des masses [1955], trad. P. Rusch et D. Renault, Paris, Éditions de l’éclat, 2008.
27. Voir D. Winnicott, L’Enfant et le monde extérieur [1957], Paris, Payot, 1972.
28. Wilfred R. Bion, Aux sources de l’expérience [1962], Paris, PUF, 1979.
29. Voir Pierre Delion, Fonction phorique, holding et institution, Toulouse, Érès, 2018 ; et P. Delion (dir.), La Pratique du packing avec les enfants autistes et psychotiques en pédopsychiatrie, Toulouse, Érès, 2007.
30. À ce propos, voir par exemple Jean Oury et Patrick Faugeras, Préalables à toute clinique des psychoses, Toulouse, Érès, 2013.
31. Bruce Bégout, Le Concept d’ambiance, Paris, Seuil, 2020.
32. Ces travaux s’appuient largement sur ceux de l’Allemand Hermann Simon, auteur d’Une thérapeutique plus active à l’hôpital psychiatrique, Berlin, Walter de Gruyter, 1929 ; ce texte a été traduit en français à l’hôpital de Saint-Alban.
33. Voir Ester Bick, « L’expérience de la peau dans les relations objectales précoces » (1967), in Meg Harris Williams (dir.), Les Écrits de Martha Harris et d’Esther Bick, Larmor-Plage, Éditions du Hublot, 1998.
34. Howard Buten, Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué [1981], Paris, Seuil, coll. « Points», 2001.
35. Voir René Roussillon, « La fonction symbolisante de l’objet », Revue française de psychanalyse, vol. 61, no 2, PUF, 1997.
36. Georges Canguilhem, Le Normal et le pathologique [1966], Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2013.
37. Voir Lucien Bonnafé, Désaliéner ? Folie(s) et société(s), Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1992.
38. M. Foucault, Blandine Barret Kriegel, Anne Thalamy et al., Les Machines à guérir : aux origines de l’hôpital moderne, Liège, Mardaga, 1979.
39. La formule est de Jean Oury, médecin, directeur de la clinique de La Borde ; voir notamment son intervention intitulée « L’analyse institutionnelle », à Tours, en 2008, lors d’une journée de l’Association des psychologues de la région Centre (Aprec), en ligne (http://bibliothequeopa.blogspot.com/2009/07/jean-oury-lanalyse-institutionnelle.html).
40. Voir D. Winnicott, « Cure » (1970), in Claire Marin et Frédéric Worms (dir.), À quel soin se fier ? Conversations avec Winnicott, Paris, PUF, 2015, p. 19-38.
41 Joan Tronto, Un monde vulnérable. Pour une politique du care [1993], Paris, La Découverte, 2009.
42. Robin A. Kearns, Wilbert M. Gesler (éd.), Putting Health into Place. Landscape, Identity and Well-Being, Syracuse (New York), Syracuse University Press, 1998.
43. Giovanna Borasi et Mirko Zardini (dir.), En imparfaite santé : la médicalisation de l’architecture, Montréal, Centre canadien d’architecture/Baden, Lars Müller Publishers, 2012.
44. Toyô Itô, L’Architecture du jour d’après, Bruxelles, Les Impressions nouvelles, 2014.
45. Tim Ingold, Marcher avec les dragons, Bruxelles, Zones sensibles, 2013.
46. Achille Mbembe, Brutalisme, Paris, La Découverte, 2020.
47. Bernard Rudofsky, Architecture Without Architects : A Short Introduction to Non-Pedigreed Architecture, New York, Doubleday & Company, 1964.
48. Denis Hollier, La Prise de la Concorde [1974], Paris, Gallimard, 1993.
49. Georges Bataille, « Architecture », Documents, no 2, mai 1929.
50. Voir Blandine Kriegel, « L’hôpital comme équipement », in M. Foucault, B. Barret Kriegel, A. Thalamy et al., Les Machines à guérir […], op. cit.
51. Voir Thomas Schlesser, L’Univers sans l’homme, Paris, Hazan, 2016.
52. Richard Grusin, The Non-Human Turn, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2015.
53. Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la violence, Paris, La Découverte, coll. « Zones », 2017.
54. Helen Zahavi, Dirty Week-end, Paris, Presses Pocket, 1992.
55. Voir Alice Cherki, Frantz Fanon, portrait, Paris, Seuil, 2000.
56. Jean Oury, « Transfert, multiréférentialité et vie quotidienne dans l’approche thérapeutique de la psychose », Cahiers de psychologie clinique, 2003/2, no 21.
57. Gisèle Durand et Jacques Lin (dir.), Cartes et lignes d’erre/Maps and Wander Lines. Traces du réseau de Fernand Deligny, 1969-1979, Paris, L’Arachnéen, 2013.
58. Voir Nicolas Brémaud, « Autisme : de bords à corps », L’Information psychiatrique, vol. 87, no 8, 2011.
59. Citons entre autres donc : George Baird, Charles Jencks, Meaning in Architecture, Londres, Barrie & Rockliff, The Cresset Press, 1969 ; Joseph Rykwert, « Meaning and Building », Zodiac, no 6, 1960 ; Umberto Eco, « Function and Sign : the Semiotics of Architecture », in James Bryan Rolf Sauer (éd.), Structures Implicit and Explicit, Philadelphie, University of Pennsylvania, 1973.
60. Bruno Fortier, « Le camp et la forteresse inversée », in M. Foucault, B. Barret Kriegel, A. Thalamy et al., Les Machines à guérir […], op. cit.
61. Ludger Schwarte, Philosophie de l’architecture, Paris, La Découverte, 2019.
62. M. Foucault, L’Archéologie du savoir [1969], Gallimard, coll. « Tel », 2015.
63. Voir Catherine Malabou, Les Nouveaux Blessés, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2007.
64. Frances A. Yates, L’Art de la mémoire [1966], Paris, Gallimard, 1987.
65. José Ortega y Gasset, à Darmstadt, en 1951, lors d’une conférence restée surtout célèbre pour l’intervention de Heidegger ; voir J. Ortega y Gasset, Le Mythe de l’homme derrière la technique, Paris, Allia, 2016.
66. Martha Nussbaum, La Fragilité du bien [1986], Paris, Éditions de l’éclat, 2016.
67. Günther Anders, L’Obsolescence de l’homme [1956], Paris, Éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2002.
68. Layla Raïd, « Care et politique chez Joan Tronto », in Pascale Molinier, Sandra Laugier, Patricia Paperman (dir.), Qu’est-ce que le care ?, Paris, Payot, 2009.
69. L. Schwarte, Philosophie de l’architecture, op. cit.
70. Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, Paris, La Découverte, 2017.